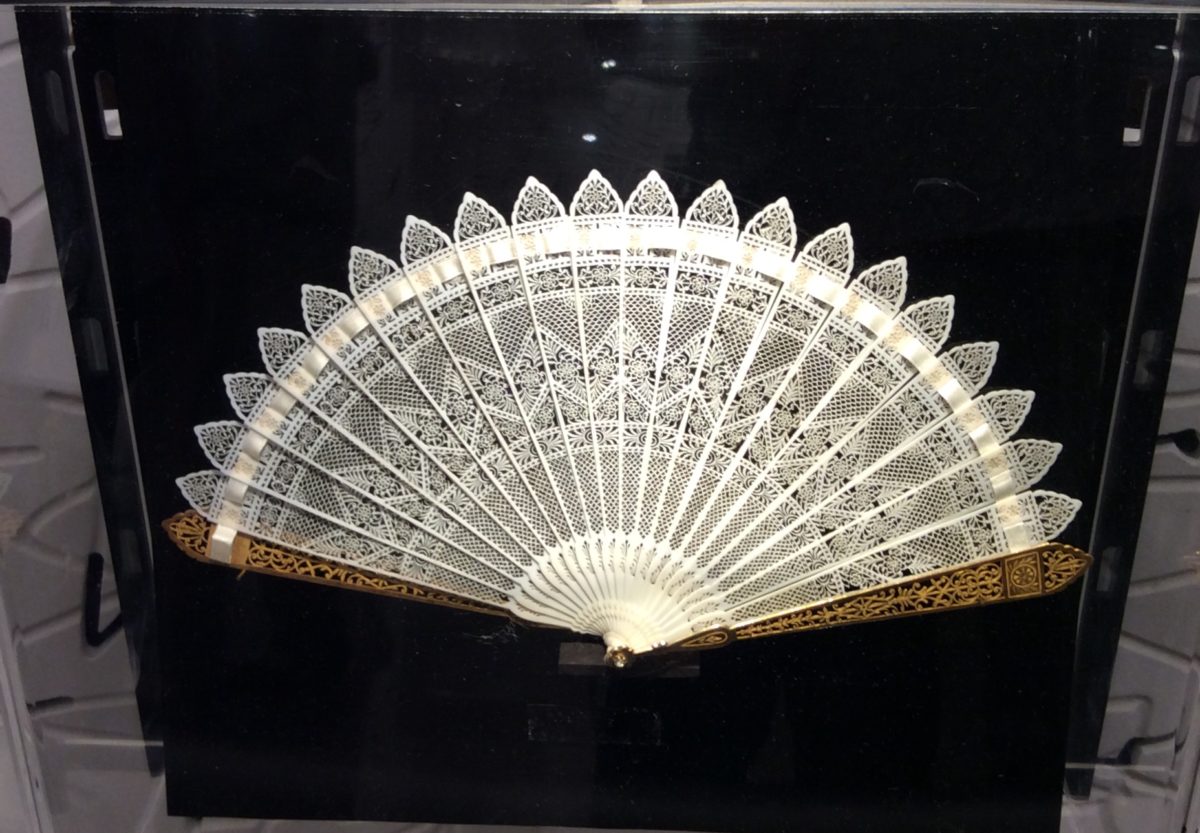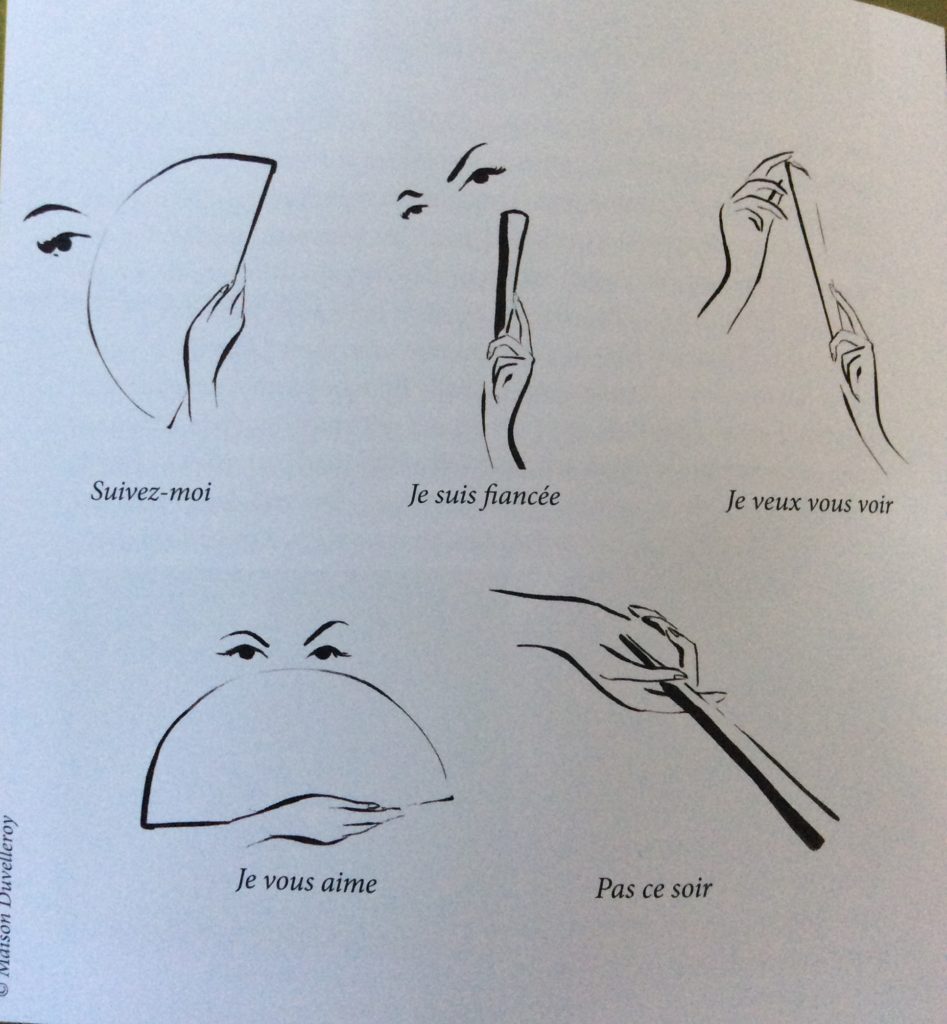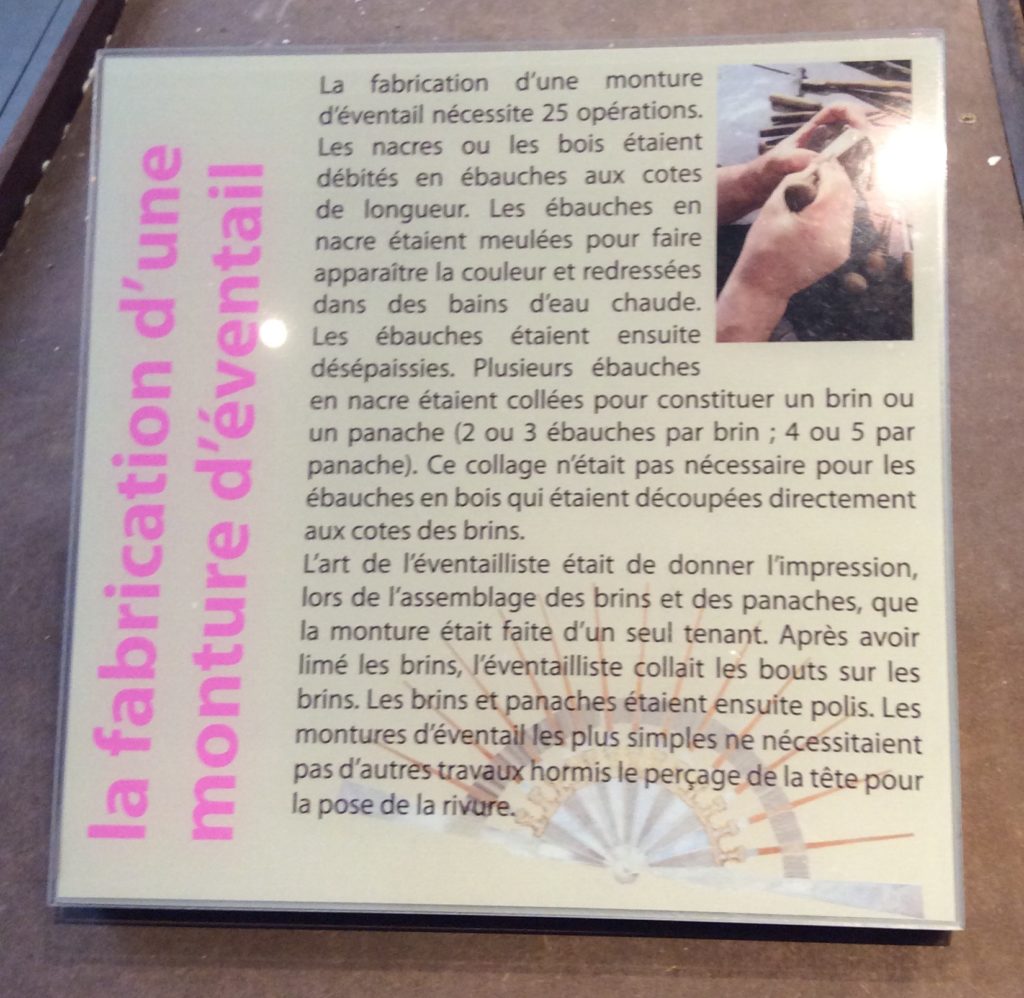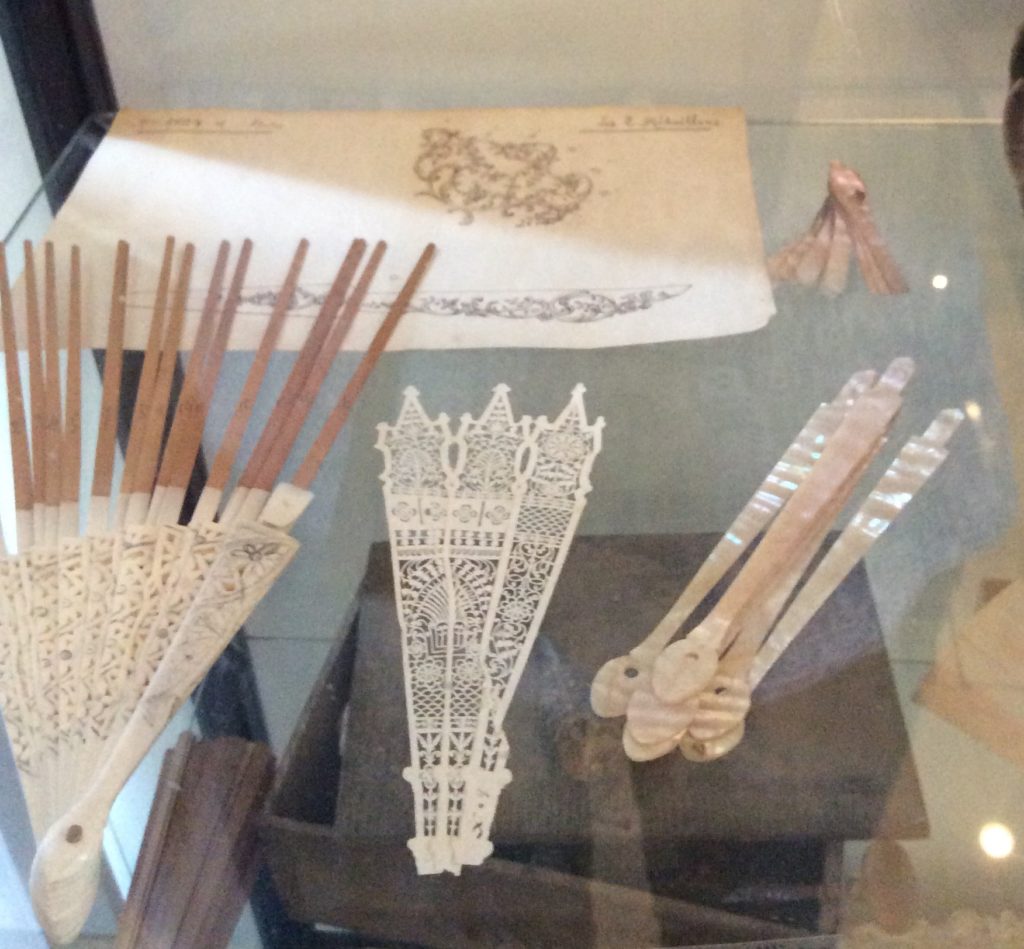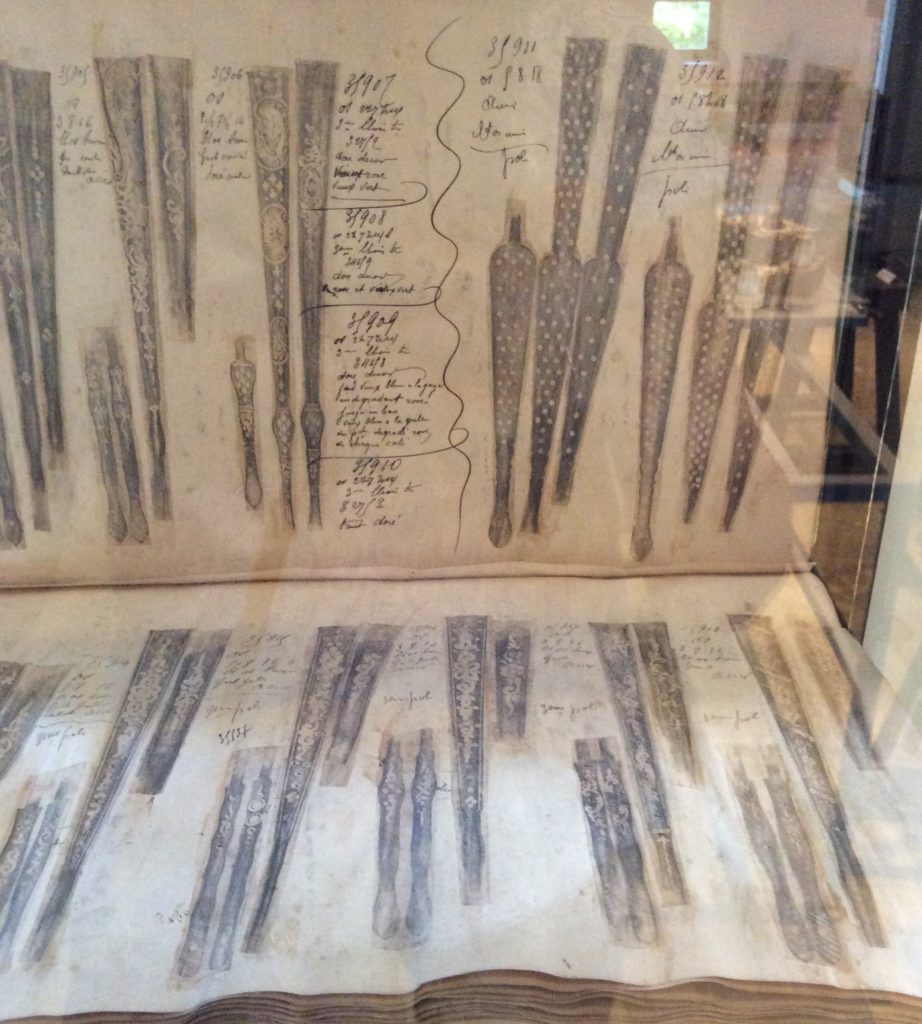Pour notre rendez-vous d’août, il y a le ciel, le soleil et la mer… Suivez-moi, nous allons à Saint-Tropez !
En 1955, si Roger Vadim réalise « Et Dieu créa la femme » en lui donnant les traits de Brigitte Bardot… Alexandre Micka, un boulanger d’origine polonaise fraîchement installé dans la cité balnéaire, crée, lui, une tarte fourrée de crème mousseline en hommage à sa grand-mère.
L’histoire dit que Micka préparait les repas pour l’équipe de tournage et qu’il servait sa fameuse tarte.
Notre B.B nationale, conquise par le dessert, lui suggéra de le nommer : « Tarte de Saint-Tropez «
Micka lui préféra le terme de : « Tarte Tropézienne » et en 1973, il déposa la marque et la recette.

Pour réaliser la tarte tropézienne, je me suis inspirée d’une recette trouvée sur le Net proche (parait-il) de l’originale car la vraie recette est « top secret » :
Pour la brioche :
275 g d’œufs (6 gros œufs )
10 g de sel
50 g de sucre en poudre
25 g lait entier
500 g de farine
20 g de levure de boulanger
250 g beurre à température ambiante
1 œuf
sucre en grains
La crème mousseline, façon Micka, est un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre.
Pour la crème pâtissière :
160 g jaune d’œufs (3 œufs moyens )
100 g de sucre en poudre
25 g de maïzena
25 g de farine
500 g de lait
Pour la crème au beurre :
45 g d’œuf (2 petits œufs )
180 g de sucre en poudre
45 g d’eau
180 g beurre à température ambiante
Utilisez de préférence un robot pour la préparation de la pâte,
Versez dans le bol, les œufs, le lait, le sucre, le sel, la farine et la levure émiettée,
Pétrissez à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte se détache des parois du bol,
Coupez le beurre mou en morceaux et ajoutez le, petit à petit, dans le bol du robot tout en pétrissant à vitesse moyenne,
Une fois le beurre incorporé, augmentez la vitesse du robot pour que la pâte forme une boule,
Rajoutez un peu de farine si la pâte est collante,
Couvrez le bol du robot d’un torchon propre et laissez la pâte doubler de volume à température ambiante,
Posez la boule de pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et donnez-lui une forme ronde légèrement aplatie,
Laissez lever à température ambiante,
Quand la brioche a de nouveau doublé de volume, battez légèrement l’œuf et dorez la délicatement au pinceau,
Saupoudrez la de sucre en grains,
Préchauffez le four à 170° (th 5/6) et enfournez dans le four chaud 40 minutes,
Vérifiez la cuisson en piquant la brioche au centre,
À la sortie du four, laissez refroidir sur une grille à température ambiante,
Pendant la première levée de la brioche, préparez la crème pâtissière.
Dans un cul de poule, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre pour les faire blanchir,
Ajoutez la maïzena, puis la farine et fouettez à nouveau,
Faites bouillir le lait et versez le en trois fois sur les œufs tout en mélangeant vivement,
Reversez le tout dans la casserole et faites cuire, en remuant constamment, jusqu’à la première ébullition,
Versez la crème pâtissière dans un plat propre, filmez-la au contact et placez-la au réfrigérateur.
Pendant la seconde pousse de la brioche, préparez la crème au beurre.
Dans le bol du robot, fouettez l’œuf entier,
Pendant ce temps, dans une casserole, versez l’eau et le sucre en poudre,
Faites chauffer ce sirop à 120° puis versez le doucement sur l’œuf tout en continuant de battre,
Laissez le fouet tourner jusqu’à ce que ce mélange refroidisse à 30°,
Coupez le beurre mou en morceaux et ajoutez le progressivement dans le bol du robot en le laissant tourner.
Lorsque les deux crèmes sont à la même température,
Fouettez légèrement la crème pâtissière pour qu’elle s’homogénéise,
Mélangez délicatement la crème pâtissière et la crème au beurre,
Versez la crème mousseline dans une poche à douille munie d’une douille lisse assez large,
Découpez les brioches dans l’épaisseur à l’aide d’un couteau scie et pochez la crème mousseline,
Recouvrez avec les chapeaux et réservez au réfrigérateur avant dégustation.
J’ai préparé ce dessert pour une dizaine de personnes et le repas s’est terminé en chantant :
🎵 Do you, do you, Saint-Tropez 🎵 (cliquez pour écouter…)
Le ciel, le soleil, la mer, la musique, les amis… Et un twist pour éliminer les calories…😏 Rien ne manque !
A bientôt pour notre prochain rendez-vous ! Et d’ici-là régalez-vous ! Moi, c’est déjà fait !
Sources :
Historique : La tarte tropezienne.fr
Recette revue à ma façon : Encore un gâteau.com
Chanson : Do you, do you, Saint-Tropez – Youtube
Photo : collection personnelle