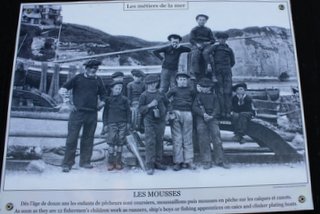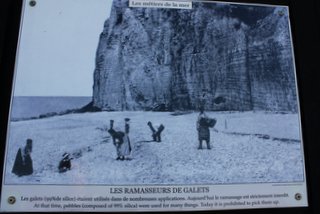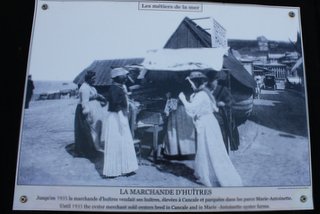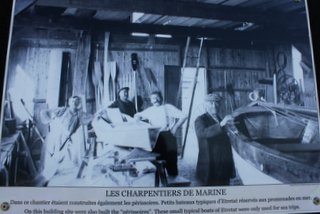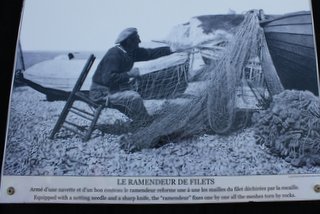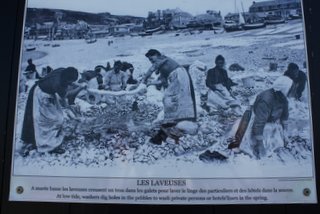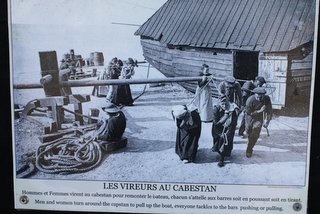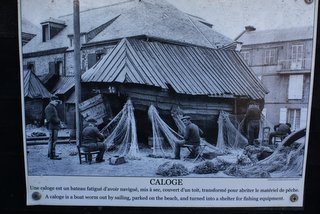Décembre prend, il ne rend.
Aujourd’hui, une surprise derrière la fenêtre du jour,
vous ne trouverez pas d’ancêtre mais une recette de ma cuisine ancestrale.
Je vous propose de réaliser une « coquille de Noël », autrefois appelée « pain de Jésus ».
Initialement spécialité wallonne, les coquilles sont également répandues dans le Nord de la France, en Picardie et en Champagne. Leur origine remonterait au IXe siècle.
Selon l’endroit, la coquille est nommée couque, cougnou, cougnolle, cugnot, guenieu.
Tous ces termes désignent une viennoiserie fabriquée uniquement pendant l’Avent.
Sa forme symbolise un nouveau-né emmailloté, une représentation du petit Jésus.
Jadis, les enfants sages recevaient une coquille soit à la Saint-Nicolas ou bien le jour de Noël avec une orange.
On peut la réaliser nature ou l’agrémenter de raisins secs, de sucre perlé ou de pépites de chocolat.
Ingrédients :
300 g de farine
15 g de levure du boulanger
15 cl de lait tiède
1 œuf + 1 jaune d’œuf
50 g de sucre
75 g de beurre
1 pincée de sel fin
Raisins secs, sucre perlé, pépites de chocolat (facultatif)
Dans un grand saladier, tamiser la farine et y réaliser une fontaine.
Délayer la levure dans le lait tiède.
Verser dans le puits formé avec l’œuf entier
Placer le sel et le sucre sur le pourtour de la fontaine.
Mélanger petit à petit la farine à la levure en ajoutant peu à peu le beurre ramolli.
Travailler à la main afin d’obtenir une boule de pâte lisse et élastique.
(Vous pouvez réaliser ces opérations dans un robot)
Couvrir d’une serviette et laisser reposer une heure à température ambiante. La pâte doit doubler de volume.
Retravailler rapidement la pâte et incorporer les raisins secs et/ou le sucre perlé, ou les pépites de chocolat.
Retirer deux petites boules de pâte et confectionner le corps de la coquille en formant un boudin.
Ajouter les boules à chaque extrémité pour figurer les deux têtes.
Jointer les trois parties entre elles.
Préchauffer le four à 200 ° en tenant compte de la spécificité de votre four.
Pour ma part, j’ai préchauffé le four à 200° puis j’ai baissé le thermostat à 180° au moment de l’enfournement)
Badigeonner l’ensemble avec le jaune d’œuf battu.
Faire cuire 30 minutes sur une plaque graissée.
Retirer du four et laisser refroidir.
En attendant notre prochain rendez-vous, régalez-vous, moi déjà c’est fait !
Mais, comme nous sommes sages, cette brioche sera présente sur notre table le matin de Noël !
Sources : www.andenne.be
Dicton du jour : www.mon-poeme.fr
Images : collection personnelle