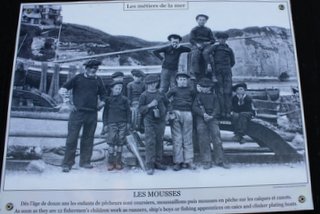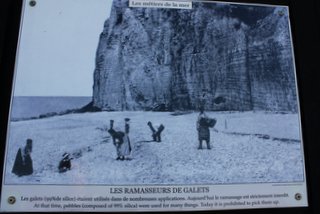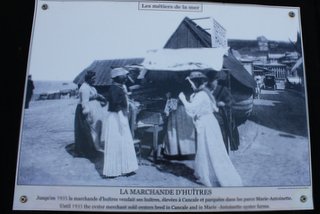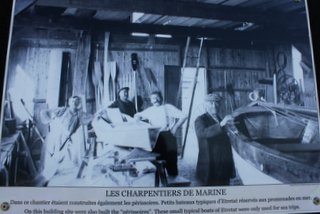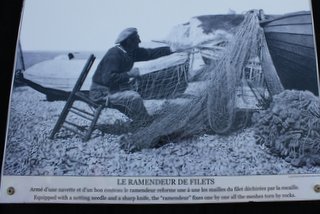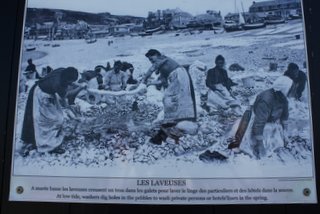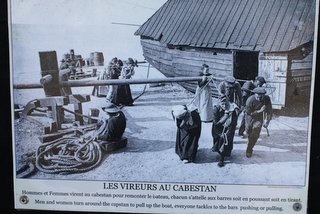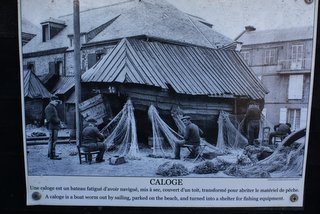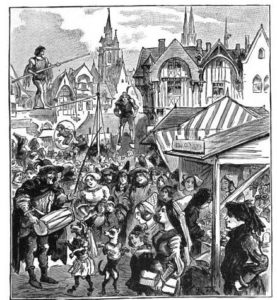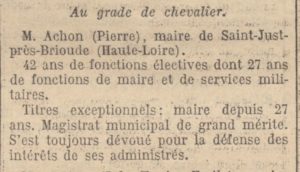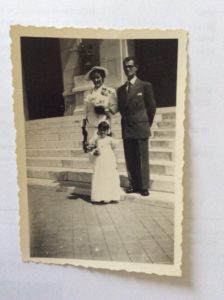Quand l’Automne, abrégeant les jours qu’elle dévore,
Éteint leurs soirs de flamme et glace leur aurore,
Quand Novembre de brume inonde le ciel bleu,
Que le bois tourbillonne et qu’il neige des feuilles,
Ô ma muse ! en mon âme alors tu te recueilles,
Comme un enfant transi qui s’approche du feu…
(Victor Hugo, Novembre…)
Oui, l’automne s’est installé… et dans la cuisine, les cucurbitacées s’invitent à nos tables.
Voilà une plante potagère magique… Une fée n’a t-elle pas transformé l’une d’elle en carrosse… D’accord, Cendrillon n’habite pas ici…
Cependant, d’un coup de cuillère en bois, je peux vous donner la recette merveilleuse du milhassou au potiron !
Dans le Sud-Ouest et depuis le Moyen-Age, les Millas désignent une grande quantité de termes qui révèlent une multitude de recettes.
Millas vient de millet, graine utilisée avant que ne lui succède le maïs venu d’Amérique.
En occitan, le maïs prend souvent le nom du millet : milh, d’où le milhas ou milhade.
Le millas est également appelé millassou, milhassou ou millasson.
Les Millas se dégustent salé ou sucré mais le terme millassou s’applique de préférence aux versions sucrées.
De nos jours, encore, on déguste ce gâteau à la clôture de la fête du cochon qui coïncide avec la récolte des potirons et autres citrouilles.
Pour 8 personnes
Préparation : 30 mn – Cuisson : 15 mn + 45 mn
500 g de chair de potiron ou de citrouille
80 g de beurre –
200 g de farine de maïs –
150 g de sucre en poudre –
5 œufs –
50 cl de lait –
5 cl de rhum ou d’armagnac (déconseillé si vous confectionnez ce gâteau pour des enfants)
zestes de 2 oranges bio râpés ou extrait de vanille
une pincée de sel
Préparer la purée de potiron en le débarrassant de la peau, graines et filandres
Couper la chair en morceaux et mettre à cuire 15 mn environ avec 20 cl d’eau
Lorsque la chair est tendre, égoutter et passer au moulin à légumes dans un grand saladier
Faire ramollir le beurre
Ajouter la farine de maïs à la purée de potiron, mélanger
Verser le sucre, le beurre ramolli, les œufs un par un, la pincée de sel
Mélanger à chaque opération
Ajouter le lait, le rhum (facultatif) et les zestes d’oranges bio ou l’extrait de vanille.
Mélanger une dernière fois
Verser la pâte dans un moule beurré
Enfourner dans le four chauffé à 180°
Cuire pendant 45 mn
Saupoudrer avec du sucre glace
Déguster tiède ou froid.
Petites variantes : Ajouter plus ou moins de sucre – Apporter d’autres parfums : Armagnac, eau de fleur d’oranger, etc… – Ajouter des pruneaux ou des raisins secs.
En prime, je vous confie un petit secret : Pour les réfractaires aux cucurbitacées, j’en connais… Voilà un moyen de leur en faire manger sans qu’ils ne s’en aperçoivent. On ne décèle pas le goût du potiron dans ce dessert.
Je vous ai prévenu, c’est magique !
En attendant notre prochain rendez-vous, régalez-vous ! Moi, c’est fait.
Sources : Wikipédia.org
Inspirée par le Petit Larousse des Saveurs des Régions de France
Images : Collection personnelle